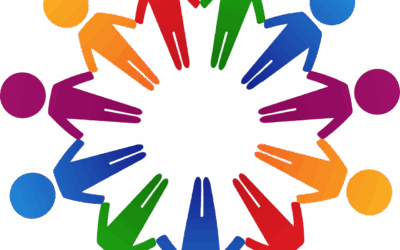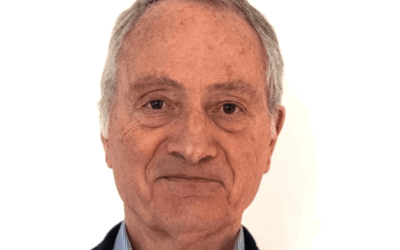Depuis quinze ans, les hôpitaux ont vu défiler une succession de réformes, programmes, plans de redressement, certifications et projets de transformation. À chaque fois, l’urgence : rattraper un déficit, respecter une norme, absorber une crise. À chaque fois, l’espoir que “cette fois-ci” sera la bonne. Mais, pour nombre de professionnels, ces démarches ont fini par se confondre dans un bruit de fond constant, où le mot “performance” évoque davantage la pression que l’inspiration.
La lassitude, un héritage des réformes permanentes
L’absentéisme qui avoisine 10 % dans les hôpitaux, le turnover supérieur à 14 % dans le secteur santé, sont des indicateurs tangibles d’une fatigue, ou plutôt d’une irritation, profondes.
La lassitude naît moins de la contrainte elle-même que de la répétition des injonctions, parfois déconnectées du terrain :
- Objectifs mouvants selon les gouvernements ou les tutelles.
- Plans d’action imposés, sans qu’on prenne le temps d’évaluer les précédents.
- Succession de “sprints” laissant peu de place à la consolidation.
- Vocabulaire de la performance trop souvent réduit à l’efficience budgétaire, au détriment du sens clinique et soignant.
Ce climat entraîne un risque majeur : une désaffection silencieuse, où l’on se contente d’appliquer sans y croire. Une sorte d’expédition des affaires courantes pour répondre à des objectifs à la fixation desquels on a le sentiment de ne pas avoir été associé.
Lier projet d’établissement ou de service, et si la « robustesse » nous aidait ?
La question que pose la recherche constante de performance, c’est celle de la capacité des équipes à tenir sur la durée. Un client nous interrogeait ainsi concernant sa cellule de gestion des lits : « J’aimerais savoir comment aider mes cadres à rester plus longtemps, la performance de la cellule est limitée car les cadres ne peuvent pas y rester longtemps en poste ».
Olivier Hamant — biologiste et directeur de recherche à l’INRAE —, nous invite, plutôt que de viser une performance maximale instantanée, à rechercher la robustesse. Celle-ci consiste à essayer de conserver la stabilité de l’organisation à court terme et sa viabilité sur le long terme malgré les fluctuations, sans chercher constamment l’optimisation et l’efficacité maximale. L’objectif serait donc de préserver la stabilité et la résilience du système, en préservant des marges, des redondances, et une capacité d’adaptation aux crises.
Ce principe nous rappelle que :
- Viser l’optimal statistique peut créer de la fragilité.
- Préparer l’avenir, c’est parfois accepter des dispositifs « moins efficaces » mais plus résistants — par exemple, maintenir une ligne de pharmacie en doublon ou garder du personnel en réserve en période de pointe.
- En santé, c’est intégrer un dispositif pérenne — même si “moins efficace” au quotidien — pour pouvoir absorber les crises, les absences massives, les ruptures de chaîne.
Oui mais quel lien avec l’approche systémique ? Cette vision encourage une approche systémique de la performance. En analysant l’entité dans son entièreté, en regardant les process au-delà des seuls chiffres, en veillant à ce que les relations soient préservées et les frictions traitées, la transformation d’un système prend la forme d’une adaptation et non d’une rupture. Elle reste absorbable pour les parties prenantes tout en s’inscrivant dans une réelle trajectoire à long terme.
Projet d’établissement et PRE, comment concilier les démarches au-delà du formalisme ?
Repartons des bases : chacun le sait, sans en être absolument convaincu, un projet d’établissement n’est pas qu’un document réglementaire à produire tous les cinq ans. C’est :
- Le fil rouge des décisions : chaque mesure, qu’elle soit budgétaire, RH, immobilière ou numérique, doit pouvoir s’y rattacher clairement.
- Un levier de cohérence interne : il fédère les projets de service, les attentes des usagers et donne une visibilité aux équipes sur la trajectoire à suivre.
Pour jouer ce rôle de boussole commune qui relie les besoins (et non l’inventaire du savoir-faire des équipes) définis avec les professionnels aux choix organisationnels, il est nécessairement « bottom up », c’est-à-dire co-construit avec les équipes. C’est la garantie du sens premier de la mission : prévenir, soigner, accompagner.
Quand il est réalisé avec les équipes, clair et partagé, le projet devient une protection contre l’erratisme des réformes successives ou une incantation méconnue des médecins : il permet de hiérarchiser les priorités et d’expliquer pourquoi certaines demandes externes sont intégrées… et d’autres non.
Il est une occasion incomparable de communiquer et de fédérer sur :
- Les valeurs renouvelées et la volonté de modernisation de l’établissement,
- Les évolutions managériales en réponse aux enjeux d’attractivité pour les soignants
- La valorisation de la politique qualité au service des patients.
Enfin, il permet d’inscrire l’établissement dans son territoire en identifiant tous les partenariats à développer, et en associant lesdits partenaires aux travaux qui les impacteront.
La transformation en actions concrètes de cette vision stratégique doit par ailleurs être pensée dès le début, avec des plans d’actions simples mais robustes, permettant notamment d’identifier les personnes responsables des actions et les modalités de suivi et d’évaluation des actions engagées. Redonner du sens au travail, recréer un collectif sont des conditions indispensables de la valorisation des équipes engagées, et de leur mobilisation dans la durée.
Et le PRE (Plan de retour à l’équilibre) dans tout ça ?
Pour les équipes administratives comme pour les équipes médicales et soignantes, concevoir et déployer 2 programmes de travail peut paraître ingérable, ces deux programmes ayant généralement des calendriers décorrélés. Pour autant, le projet d’établissement ne se fait jamais à moyens constants, et le PRE est souvent nécessaire pour dégager les ressources qui permettront de financer le projet d’établissement. Inversement, le PRE doit pouvoir trouver une traduction dans un projet stratégique, sans quoi deux réalités évoluent en parallèle, l’une relevant de l’utopie et se heurtant à l’absence de financement, l’autre étant constitué de morceaux de projets sans structure ni stratégie. Enfin, la soutenabilité économique de la structure ne doit pas rimer avec l’arrêt complet de tous les projets qui ont mobilisé les équipes et donnent du sens à leur quotidien, car ils garantissent la qualité de la prise en charge des usagers.
Ainsi, le PRE, s’il est bien conçu, doit permettre de :
- Traduire le projet d’établissement en trajectoire financière crédible.
- Séquencer les actions : ce qui relève de l’urgence budgétaire, ce qu’il est indispensable de faire pour préserver la qualité des soins et l’accès aux soins sur le territoire, ce qui sert la transformation, ce qui prépare l’avenir.
- Devenir un outil de dialogue avec les tutelles, permettant de négocier délais et marges de manœuvre en s’appuyant sur un cap stratégique.
Il impose souvent une priorisation des projets composant le projet d’établissement. Cette priorisation sera d’autant plus entendable par les équipes qu’elle sera communiquée de manière transparente et inscrite dans un projet cadre plus attractif que le strict projet d’efficience.
L’articulation entre le projet d’établissement et le PRE permet enfin d’éviter l’écueil d’un PRE “tableur”, centré uniquement sur les économies court terme au détriment de l’investissement dans les leviers structurels.
Trois horizons pour (re)mobiliser et transformer
Pour qu’un hôpital retrouve de l’élan collectif, il faut articuler trois échelles de temps et les adosser à des objectifs CAPE (concrets, atteignables, partagés et évaluables) :
- Court terme – Gagner vite en crédibilité
- Identifier et corriger les irritants immédiats (tâches inutiles, blocages logistiques, doublons administratifs).
- Obtenir des résultats visibles dans les 90 premiers jours pour démontrer que le changement est possible tout en mesurant l’impact sur la qualité des soins.
- Moyen terme – Transformer avec un impact palpable
- Lancer 2 ou 3 chantiers structurants qui modifient réellement l’expérience soignants/patients (nouvelle organisation de service, modernisation d’un plateau technique, refonte des plannings).
- Ancrer ces chantiers dans le projet d’établissement pour éviter la dispersion.
- Long terme – Bâtir l’avenir de la structure
- Développer les compétences managériales (formation, compagnonnage, appui externe).
- Installer une culture d’évaluation et de pilotage par les résultats cliniques, économiques et sociaux.
- Consolider les coopérations territoriales (GHT, ville-hôpital, médico-social) pour élargir la base d’efficience.
Le rôle d’un “sparring partner”
Dans un contexte d’usure managériale, l’accompagnement externe ne doit pas être vécu comme un contrôle de plus.
Le “sparring partner” :
- Écoute et co-analyse avec les équipes.
- Aide à séquencer les priorités selon l’impact et le réalisme.
- Renforce la capacité des managers à piloter dans la durée.
- Reste présent pour soutenir la mise en œuvre, y compris dans les moments de tension.
En résumé
Remobiliser, c’est accepter de regarder en face la fatigue accumulée, puis rouvrir le champ des possibles en reconnectant les objectifs financiers au projet de soin. C’est aussi donner aux équipes un horizon clair, avec des victoires rapides pour retrouver la confiance, et des transformations visibles pour maintenir l’adhésion.
Besoin d’aide pour identifier vos marges de manœuvre en termes de performance, envie de découvrir notre approche et notre outil d’analyse systémique des difficultés des établissements médico-sociaux ? Chez ADJ Partenaire, nous faisons de chaque thématique une opportunité de donner du sens à vos équipes tout en mobilisant une véritable expertise métier. Parlons-en ici.
Découvrez les expertises au service de vos problématiques : expertises